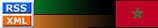Tuesday, September 12, 2006
Au lieu de rester hier à Barcelone voir la commémoration du 11 septembre un peu partout (non non pas le 11.09 que vous croyez, celui de la Catalogne), ou voir à la télé des images en boucle des deux tours jumelles de NYC s'écrouler en m'énervant parce que personne ne parle du 11.09.73 au Chili, un 11.09 aussi mais qui avait fait environ 4.500 morts, par la main directe et indirecte de l'Oncle Sam... au lieu de cela donc, j'ai préféré aller prendre du bon temps. A Perpignan (à 2 heures de Barcelone). Depuis le 2 septembre et jusqu'a ce dimanche 17 septembre se tient la 18ème édition du l'exposition photographique Visa Pour l'Image. C'est une des manifestations majeures de la photographie mondiale, extrêment riche en clichés de reporters de guerre.
J'y ai aperçu de loin au Couvent des Minimes le géant de la photo Patrick Chauvel, un grand monsieur qui a couvert de nombreuses guerres et a plusieurs fois été blessé au front de l'image. Il partait et je n'ai pu l'aborder pour lui téoigner mon admiration. Dommage...
A voir absolument les expositions de Stanley Greene, de Hiromi Nagakura (sublime expo sur Massoud, 500 jours passé auprès du Che Guevara Afghan), d'Alvaro Ybarra Zavala (Les enfants de la douleur), Pablo Cerolini et Alejandro Reynoso avec En Negro et Blanco couvrant les années de plomb en Argentine, de Philip Blenkinsop couvrant la révoltes des rebelles maoïstes de 2001 à 2006...
Visa pour l'image
Interview de Stanley Greene dans Lemonde le 10.09.06
"Le racisme aux Etats-Unis est un monstre tapi"
LE MONDE 09.09.06 13h57
Difficile, devant ce corps délicat et cette voix douce, de croire que l'Américain Stanley Greene (agence Vu) a 57 ans et une longue carrière de photographe de guerre. Il s'est fait connaître par ses visions hantées de la Tchétchénie, où il est allé plus de vingt fois. Au festival Visa pour l'image, il présente une exposition consacrée à l'Irak et un travail collectif sur l'ouragan Katrina. Deux sujets autour de l'Amérique, qu'il a quittée il y a vingt ans.
Ce travail sur Katrina est-il un retour aux sources ?
Ça m'a donné l'opportunité de consacrer un sujet à mon pays. Et c'est un retour aux sources aussi parce que ce travail se rapproche beaucoup de celui des photographes de la FSA avec Walker Evans, dans les années 1930.
Ce sujet collectif met l'accent sur le racisme. Pourquoi ?
Katrina a servi de révélateur au racisme généralisé des Etats-Unis. Je l'ai vécu moi-même ! Nous occupions une maison louée par le magazine Time. J'étais le seul Noir parmi les journalistes. La police nous a harcelés. Un policier blanc a demandé à tout le monde ses papiers. Sauf à moi : il m'a plaqué contre le mur, presque nu, devant mes collègues embarrassés. Si je lui avais ouvert la porte, il m'aurait mis une balle dans la tête. Il disait : "Ce type n'est pas journaliste, je le sais."
Ce sujet vous tient à cœur ?
Mon père appartenait au mouvement Harlem Renaissance et a défendu bien d'autres causes, il a été mis sur liste noire à cause de ses sympathies communistes. Moi, j'ai milité pour les droits civiques. Le racisme aux Etats-Unis est un monstre tapi qui se réveille à la moindre occasion. Le Ku Klux Klan sévissait dans le Sud il n'y a pas si longtemps. Comme par hasard, dans les quartiers blancs, les supermarchés ont été ouverts aux gens, par solidarité. Dans les quartiers noirs, on a mis des gardes pour les empêcher de rentrer !
Pourquoi faire un travail collectif avec Thomas Dworzak, Paolo Pellegrin et Kadir van Lohuizen ?
On a chacun notre personnalité, on se connaît depuis longtemps. Ce travail est une jam-session, sauf qu'il s'agit de musique visuelle. Ça donne une image plus variée, complète de la réalité. Le tout est construit comme un film de cinéma : l'ordre, la présentation, les légendes sont très contrôlés. C'est important pour raconter une histoire. Nous avons choisi une accumulation d'images, sans légendes.
Pourquoi y être revenu ?
Pour mettre à jour le cynisme. On retrouve les mêmes personnes dans la même merde. Le but n'est pas de faire revenir les gens, mais de faire de La Nouvelle-Orléans une ville blanche et lucrative. Cette ville a été créée par des esclaves, contrairement à Baton Rouge (Louisiane), fondée par les Confédérés. Beaucoup d'Américains voient La Nouvelle-Orléans comme un lieu de péché. Pour eux, les inondations sont un moyen de se débarrasser de la prostitution, du crime et de la drogue, et de favoriser les investissements. D'où ces images de pancartes avec des annonces immobilières. Des investisseurs recherchent partout les propriétaires des maisons détruites. Qu'ils rachètent pour 10 000 dollars. Katrina est la plus grande opération de spoliation de tous les temps.
Comment avez-vous travaillé ?
La ville était pleine de barrages, du FBI, de la police. Sans compter les services de sécurité privés, comme Black Water, qui nous empêchaient d'entrer dans le Renaissance Village, un des quartiers les plus pauvres, les plus sinistrés, les plus visés par la spéculation immobilière. Ces gens tirent sans sommation ! Ironiquement, la même compagnie opère en Irak pour le compte d'Haliburton, la société de Rumsfeld. Ce sont les cadavres de deux employés de Black Water que j'ai photographiés à Falloujah.
Que vous attendiez-vous à trouver en Irak en 2004 ?
Un an après l'opération "Tempête du désert", la coalition était censée mettre en place la démocratie. Mais, à Falloujah, on n'a vu que cette haine en train de bouillir. Tuer quelqu'un avec un fusil, c'est une chose. Mais l'empêcher de sortir de sa voiture après un attentat pour qu'il crame, puis pendre son cadavre à un pont... Il y a quelque chose qui s'est brisé chez moi.
Là aussi, vous êtes revenu plus tard.
Il me fallait suivre aussi le côté américain pour montrer que le fanatisme est des deux côtés. Allah Akhbar, God bless you : il n'y a pas tant de différence. La religion est une bonne chose quand elle sert de code moral, pas quand elle est utilisée pour commettre des crimes.
Vous avez un discours et des photos très engagés. Que faites-vous de l'objectivité du photojournaliste ?
Je ne suis pas objectif. Je montre ce qui se passe, de façon humaine, avec mon point de vue. J'essaie de transmettre ma colère, mes questions. Mais je ne fais pas de la propagande, je ne fais pas mentir les images. Je montre les deux vérités, et je donne à voir les victimes.
J'y ai aperçu de loin au Couvent des Minimes le géant de la photo Patrick Chauvel, un grand monsieur qui a couvert de nombreuses guerres et a plusieurs fois été blessé au front de l'image. Il partait et je n'ai pu l'aborder pour lui téoigner mon admiration. Dommage...
A voir absolument les expositions de Stanley Greene, de Hiromi Nagakura (sublime expo sur Massoud, 500 jours passé auprès du Che Guevara Afghan), d'Alvaro Ybarra Zavala (Les enfants de la douleur), Pablo Cerolini et Alejandro Reynoso avec En Negro et Blanco couvrant les années de plomb en Argentine, de Philip Blenkinsop couvrant la révoltes des rebelles maoïstes de 2001 à 2006...
Visa pour l'image
Interview de Stanley Greene dans Lemonde le 10.09.06
"Le racisme aux Etats-Unis est un monstre tapi"
LE MONDE 09.09.06 13h57
Difficile, devant ce corps délicat et cette voix douce, de croire que l'Américain Stanley Greene (agence Vu) a 57 ans et une longue carrière de photographe de guerre. Il s'est fait connaître par ses visions hantées de la Tchétchénie, où il est allé plus de vingt fois. Au festival Visa pour l'image, il présente une exposition consacrée à l'Irak et un travail collectif sur l'ouragan Katrina. Deux sujets autour de l'Amérique, qu'il a quittée il y a vingt ans.
Ce travail sur Katrina est-il un retour aux sources ?
Ça m'a donné l'opportunité de consacrer un sujet à mon pays. Et c'est un retour aux sources aussi parce que ce travail se rapproche beaucoup de celui des photographes de la FSA avec Walker Evans, dans les années 1930.
Ce sujet collectif met l'accent sur le racisme. Pourquoi ?
Katrina a servi de révélateur au racisme généralisé des Etats-Unis. Je l'ai vécu moi-même ! Nous occupions une maison louée par le magazine Time. J'étais le seul Noir parmi les journalistes. La police nous a harcelés. Un policier blanc a demandé à tout le monde ses papiers. Sauf à moi : il m'a plaqué contre le mur, presque nu, devant mes collègues embarrassés. Si je lui avais ouvert la porte, il m'aurait mis une balle dans la tête. Il disait : "Ce type n'est pas journaliste, je le sais."
Ce sujet vous tient à cœur ?
Mon père appartenait au mouvement Harlem Renaissance et a défendu bien d'autres causes, il a été mis sur liste noire à cause de ses sympathies communistes. Moi, j'ai milité pour les droits civiques. Le racisme aux Etats-Unis est un monstre tapi qui se réveille à la moindre occasion. Le Ku Klux Klan sévissait dans le Sud il n'y a pas si longtemps. Comme par hasard, dans les quartiers blancs, les supermarchés ont été ouverts aux gens, par solidarité. Dans les quartiers noirs, on a mis des gardes pour les empêcher de rentrer !
Pourquoi faire un travail collectif avec Thomas Dworzak, Paolo Pellegrin et Kadir van Lohuizen ?
On a chacun notre personnalité, on se connaît depuis longtemps. Ce travail est une jam-session, sauf qu'il s'agit de musique visuelle. Ça donne une image plus variée, complète de la réalité. Le tout est construit comme un film de cinéma : l'ordre, la présentation, les légendes sont très contrôlés. C'est important pour raconter une histoire. Nous avons choisi une accumulation d'images, sans légendes.
Pourquoi y être revenu ?
Pour mettre à jour le cynisme. On retrouve les mêmes personnes dans la même merde. Le but n'est pas de faire revenir les gens, mais de faire de La Nouvelle-Orléans une ville blanche et lucrative. Cette ville a été créée par des esclaves, contrairement à Baton Rouge (Louisiane), fondée par les Confédérés. Beaucoup d'Américains voient La Nouvelle-Orléans comme un lieu de péché. Pour eux, les inondations sont un moyen de se débarrasser de la prostitution, du crime et de la drogue, et de favoriser les investissements. D'où ces images de pancartes avec des annonces immobilières. Des investisseurs recherchent partout les propriétaires des maisons détruites. Qu'ils rachètent pour 10 000 dollars. Katrina est la plus grande opération de spoliation de tous les temps.
Comment avez-vous travaillé ?
La ville était pleine de barrages, du FBI, de la police. Sans compter les services de sécurité privés, comme Black Water, qui nous empêchaient d'entrer dans le Renaissance Village, un des quartiers les plus pauvres, les plus sinistrés, les plus visés par la spéculation immobilière. Ces gens tirent sans sommation ! Ironiquement, la même compagnie opère en Irak pour le compte d'Haliburton, la société de Rumsfeld. Ce sont les cadavres de deux employés de Black Water que j'ai photographiés à Falloujah.
Que vous attendiez-vous à trouver en Irak en 2004 ?
Un an après l'opération "Tempête du désert", la coalition était censée mettre en place la démocratie. Mais, à Falloujah, on n'a vu que cette haine en train de bouillir. Tuer quelqu'un avec un fusil, c'est une chose. Mais l'empêcher de sortir de sa voiture après un attentat pour qu'il crame, puis pendre son cadavre à un pont... Il y a quelque chose qui s'est brisé chez moi.
Là aussi, vous êtes revenu plus tard.
Il me fallait suivre aussi le côté américain pour montrer que le fanatisme est des deux côtés. Allah Akhbar, God bless you : il n'y a pas tant de différence. La religion est une bonne chose quand elle sert de code moral, pas quand elle est utilisée pour commettre des crimes.
Vous avez un discours et des photos très engagés. Que faites-vous de l'objectivité du photojournaliste ?
Je ne suis pas objectif. Je montre ce qui se passe, de façon humaine, avec mon point de vue. J'essaie de transmettre ma colère, mes questions. Mais je ne fais pas de la propagande, je ne fais pas mentir les images. Je montre les deux vérités, et je donne à voir les victimes.